
Explorer l’origami qui surgit
Ce samedi 28 juin, je suis arrivée tôt sur la place de l’hôtel de ville à Sotteville, sans intention d’assister tout de suite au programme de la 36e édition du festival Viva Cité qui a commencé la veille. Je me suis assise sur un muret, à un endroit où il ne se passe apparemment rien, et je laisse décanter les sons du jour d’avant pour qu’ils puissent finir leurs réverbérations en moi et se mêler aux mille et un bruissements de la journée qui commence. Je connais bien ce lieu, j’habite non loin. Je songe à cet article que l’Atelier 231 m’a proposé pour Réflexions en Suspension : comment le féminisme travaille-t-il les créations, le public, l’espace, dans un festival des arts de la rue en 2025 ? Est-ce que cela s’entend ? Depuis 20 ans j’écoute les espaces publics depuis ma position de femme cis, blanche, engagée dans les luttes sociales, aujourd’hui quadragénaire et valide : j’observe les dominations qui s’y exercent, les émancipations qui s’y ouvrent, l’inépuisable complexité du réel. Les endroits où il ne se passe rien ont ma prédilection, ceux où il n’est pas prévu que l’on s’installe en spectatrice : on peut y interrompre ses propres scripts et s’y rendre disponible à ce qui foisonne de toutes parts. Comme bien d’autres personnes pour de multiples raisons, il m’est plus difficile de me rendre à un événement qui m’assigne officiellement au rôle de spectatrice, mais les arts de la rue ouvrent les latitudes : je suis du public ou je n’y suis plus, je contribue ou je reste en retrait, je m’échappe ou je plonge, je reviens, je dérive. L’espace se compose en un origami tranquille, jamais fini, laissant apparaître des chemins imprévus, accessibles à toutes et tous.
Ce samedi matin, sur la grande place de l’hôtel de ville, les voitures habituellement garées là ont cédé la place à un entrelacs de barrières, de câbles électriques, de haut-parleurs, de structures métalliques, de caisses de transport, de techniciennes qui s’affairent, de comédiens qui s’échauffent. Des enfants crient de joie au milieu des fontaines au sol, la piscine des quartiers populaires. Un groupe prévu le soir a commencé ses répétitions sur un gros système son : la batterie surgit, s’éteint, recommence, au rythme des calages, tout cela s’accorde dans le paysage d’une matinée de fête. Un jeune trisomique, venu avec d’autres personnes handies [1] , se met à danser, et un vieil homme lui répond, tout sourire, par quelques pas de tango de l’autre côté de la pelouse. Comme moi, ils explorent les chemins ouverts par l’origami. Des ados du lycée du coin passent, l’air maladroitement assuré, l’air de n’être plus seulement des lycéens du coin : hier ils jouaient, dans le in, une pièce travaillée au fil des mois précédents avec le Groupe ToNNe [2]. Devant moi, sur les pavés, il y a des signes colorés au sol, ils marquent peut-être l’emplacement des accessoires d’un spectacle à venir – à moins qu’ils n’aient servi de repères scénographiques à des acrobates ? Deux danseuses s’activent depuis un moment parmi ces signes, elles répètent des séries de gestes, chacune de façon autonome, échangeant parfois quelques mots, attentives à ce qui se passe autour d’elles et concentrées, pourtant, sur leurs séquences mimées. L’une d’elle, installant la scène entre deux mouvements, vient poser un banc près de moi et le transforme aussitôt en petit pont pour venir me parler : ces gestes répétés, ils ont été recueillis par les membres de la compagnie Sauf le dimanche auprès de personnes passant là, à ces endroits marqués au sol. Ils permettront de composer la chorégraphie de ce soir, Assemblée. D’ailleurs, on est en phase de collecte, aurais-je envie d’échanger sur ce qu’on partage dans l’espace public et de donner un geste qui résumerait mon propos ? Je m’étais assise toute au bord de l’origami et me voilà rendue, d’un pli, au beau milieu.

Au fil de ce dialogue doucement brodé, je ne peux m’empêcher de penser aux surgissements spectaculaires qui caractérisaient les arts de la rue au moment de leur structuration professionnelle dans les années 1980, au moment aussi où ils se trouvaient majoritairement composés d’hommes blancs valides. On débarquait, on s’imposait, on en mettait plein la vue et plein l’ouïe, grandes formes, grosses machines, énergie virile [3]. Ici, comme dans le milieu artistique plus général, on érigeait la singularité et la dissidence en valeurs fondamentales, tout en reproduisant des formes de domination aujourd’hui questionnées plus frontalement. La chercheuse britannique Marie Thompson a par exemple produit un travail critique important, au sein du champ des musiques expérimentales et de l’écologie sonore, sur la masculinité blanche : elle a notamment soulevé que cette dernière se percevait comme transparente et universelle, utilisant cette représentation d’elle-même pour silencier d’autres perspectives [4].

Il faudrait écrire aussi l’histoire de la masculinité blanche dans les arts de la rue : comment elle s’inscrit dans une histoire populaire, celle de saltimbanques revendiquant un droit à la culture, à la ville, à la fête ; comment elle s’est construite en confrontation aux usages bourgeois du spectacle et de l’urbanisme ; comment elle s’est nourrie de l’épopée technique occidentale et l’a nourrie à son tour ; comment elle résulte, elle aussi, de siècles de mises à l’écart des femmes et de bien d’autres minorités ; comment elle les a poursuivies ; comment elle a évolué, à partir de la fin du 20e siècle, pour s’ouvrir à des modes de jeu et, en amont, de gouvernance, moins univoques.
Au moment de ma rencontre avec la compagnie Sauf le dimanche en ce samedi matin, me revient en tête le livre d’Estelle Zhong Mengal, Apprendre à voir [5]. L’historienne de l’art décrit comment la mode des récits héroïques d’explorateurs naturalistes à l’autre bout du monde, à la fin du 19e siècle, avait écrasé et renvoyé à l’oubli un mouvement antérieur instaurant une relation bien différente aux autres espèces et à soi-même : celui de femmes qui observaient l’environnement naturel depuis les espaces domestiques auxquelles elles étaient assignées, et qui s’attachaient à rencontrer les plantes qui vivaient là, à connaître leur nom pour ne plus « vivre en étrangère » parmi elles. « Nos lieux d’actions sont multiples : ce sont nos lieux de vie, nos lieux quotidiens. », écrit Sauf le dimanche, « Nous chorégraphions la rencontre » [6] . Nulle essence féminine ici, mais un rapport au monde enraciné dans une condition minorisée, commune à divers groupes sociaux : les enfants, les personnes handies, racisées, pauvres, déviant des normes de genre, vieilles, grosses, petites, malades… L’énumération pourrait se poursuivre longuement, car la norme, en réalité, ne s’incarne dans des corps que de façon rare et forcément éphémère. Elle sert à invisibiliser et délégitimer les variations infinies des manières de s’habiter soi-même et d’habiter le monde. Les arts de la rue font partie des milieux où il devient possible de les rendre perceptibles, de travailler la société par ses marges. Rien n’y est résolu en cette année 2025, rien ne pourra jamais y être achevé, mais des processus variés ont éclos, que l’approche féministe, entre autres, permet de repérer et d’activer. Dans les plis et contre-plis de ce que j’ai pu voir au festival Viva Cité cette année, des pas de côté s’opèrent, des récits sortent de l’effacement, des perspectives se renversent radicalement, des capacités d’agir jusque-là écrasées s’affirment, d’autres formes de relations et de créations s’inventent.
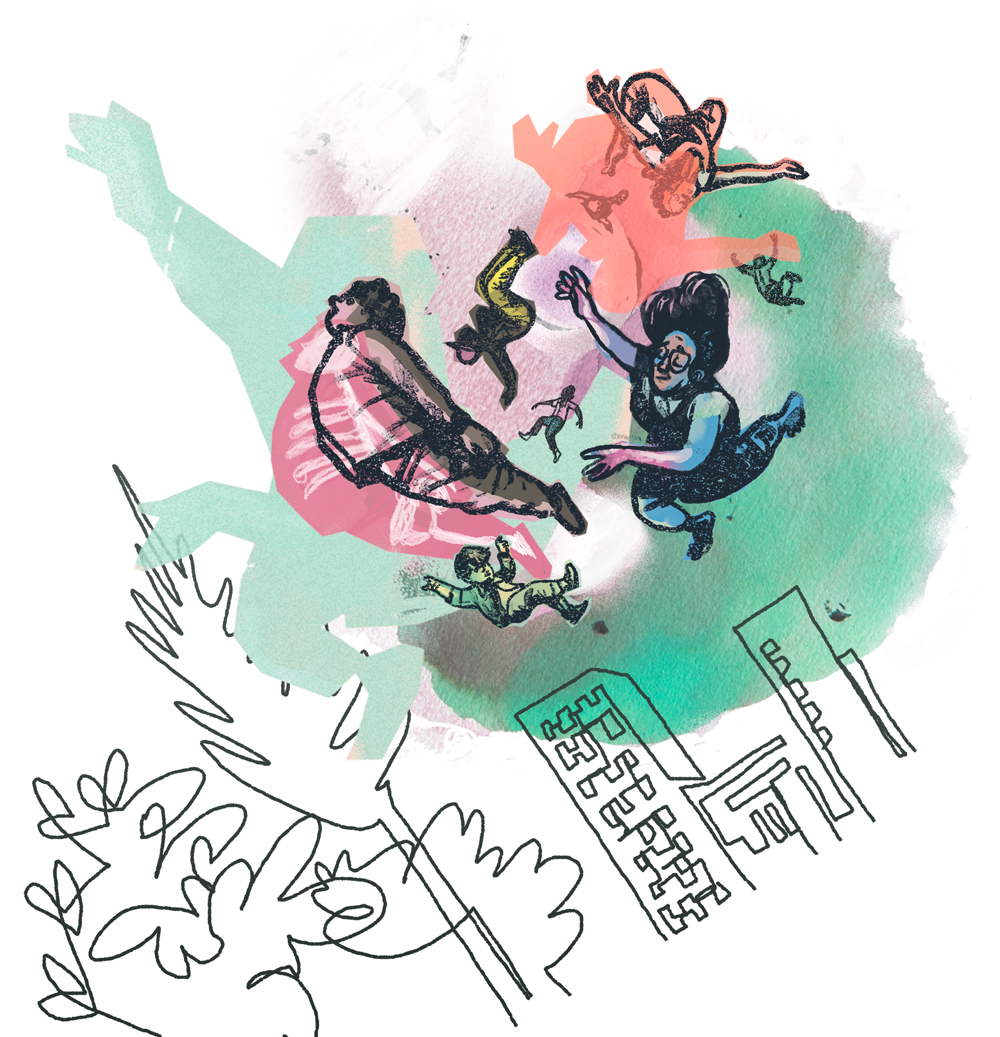
Comment le féminisme peut plier et déplier l’espace
Premier pli : la normativité, précisément, peut apparaître dans tout son grotesque et toute son oppression – celle des stéréotypes de genre et plus généralement celles qui entravent nos volontés d’émancipation. Le duo de Cris Clown, dans Home, exploite les ressorts du mime et du théâtre populaire pour mettre en relief les inégalités persistantes dans le travail domestique gratuit chez les couples hétérosexuels : bagarre frénétique et sans fin avec les corvées quotidiennes pour la femme, train-train éteint de tâches autocentrées pour l’homme. Un miroir à peine déformant posé face au public, l’invitant à déserter un modèle aussi étriqué : « 68 % des femmes font la cuisine ou le ménage chaque jour, contre 43 % des hommes » selon le dernier rapport de l’Observatoire des inégalités en France, en mars 2025. Dans Levántate, soulève-toi !, la compagnie Sale Gamine mobilise une figure féminine toute aussi hyperactive, mais dans une posture de libération illusoire cette fois. Elle met en scène les personnages de Mala chica (la mauvaise fille) et Molo chico (le garçon molasson) pour proposer une exubérante parodie musicale du capitalisme digérant les vellétités contestataires – et pour étriller au passage notre assentiment tacite. Un spectacle change-t-il des statistiques ? Pas tout à fait et pas tout seul, mais il rend justice, le temps d’une représentation, et sème d’autres manières de percevoir ce qui semblait inévitable ou naturel.

Deuxième pli : le prisme féministe, parmi d’autres, permet de fissurer les discours établis pour extraire des récits minorisés de leur longue suppression. Ainsi dans Les quatre côtés du miroir de la Youle Compagnie : jouée par une femme arabe, une femme noire, une femme blanche, la pièce s’appuie sur une collecte de témoignages pour donner voix à des aspects silenciés de la guerre d’Algérie. Par exemple les viols massifs qui s’y sont produits et les résistances qui s’y sont construites. Une exclamation et une image me restent : « Et les femmes ? Elles sont où les femmes ? Elles ont été nombreuses à se rouler dans la bouse. Elles se sont roulées dans la merde pour ne pas être emmerdées. Elles se sont balafrées pour devenir sorcières. » Les comédiennes ne cessent de s’interrompre mutuellement pour faire surgir des pans d’histoires invisibilisés. Le musicien-DJ varie les supports audios et les fait jouer avec les interventions en direct. La comédienne arabe se lance dans un énergique slam en arabe, elle me fait songer à ces concerts de free jazz où chaque instrumentiste trouve son moment d’impro en solo avant de revenir au jeu commun dans un fondu-enchaîné d’applaudissements. Le processus de justice sociale ne se termine jamais, il faut toujours lutter contre de nouveaux effacements et rendre leur voix à des personnes.
Troisième pli : les perspectives dominantes se trouvent renversées pour transmettre fierté et capacité d’agir à des personnes minorisées, et faire vaciller les groupes dominants sur leurs piédestaux de privilèges. Dans Superbe(s), le Group Berthe met en scène un moment de rééquilibrage collectif jubilatoire au beau milieu du passage entre deux bâtiments. Parmi les possibilités d’espaces très ouverts qu’offre le site de l’Atelier 231, c’est dans un endroit sous contrainte, comme un large couloir encadré d’une scène et d’une régie, que s’organise la dérive. Utilisant le féminin universel pour s’adresser au public, une comédienne anime la piste façon boîte de nuit démasculinisée. Tout le monde est invitée à marcher fièrement comme une mannequin et à expérimenter d’autres expressions de genre à travers la danse : « Bravo Magali, tu es devenue top model ! » lance la régisseuse-coach avant d’enchaîner sur un nouveau mouvement. Dans Préliminaires, pénétration, orgasme ?, la Centrifugeuse compagnie aborde cet empouvoirement par l’intime, à travers le monologue ironique d’une femme cis sur l’évolution de sa sexualité au fil des années. Les représentations et pratiques hétéronormées se voient étrillées comme un haut lieu de domination masculine, laissant place à d’autres types de rapports amoureux, sociaux et à soi-même. Le stand-up s’affirme comme outil d’éducation populaire, ancré dans les luttes féministes de la dernière décennie contre la culture du viol, #MeToo et #BalanceTonPorc. Contrairement à la plupart des autres créations, j’y perçois aussi les échos des combats intersectionnels et queers à l’intérieur du féminisme, pour le confronter aux réalités des personnes non blanches et non hétéras. De nouvelles normes s’instituent, déplaçant les frontières de ce qu’il est possible de penser, de dire, d’être, et de recevoir. Deux soirs, je tente d’accéder au spectacle de la danseuse Amy Wood, I want to break freak, deux soirs j’échoue, ainsi vont les tours et détours d’un festival – je crois qu’il aurait trouvé sa place ici.
Quatrième pli : le renversement se poursuit jusqu’à ouvrir au public des paysages inconnus, des perceptions inattendues, des relations nouvelles. Dans Rouge Merveille de la compagnie Rhizome, l’art du trapèze se transforme radicalement : la création a été conçue par une équipe de femmes, la structure porteuse évoque un stérilet géant, la vitesse et les saltos cèdent le terrain à la suspension et à la lenteur. La virtuosité se situe dans cette quasi immobilité, rendue possible par une grande maîtrise physique et psychologique. La suspensive [7] tient par une seule main à plusieurs mètres au-dessus du sol avec un tel naturel qu’une enfant s’exclame : « On dirait qu’elle marche dans l’air ! » L’origami se poursuit dans le ciel. Elle lit, là-haut, elle observe, elle « se laisse traverser par ce qui se passe dans le public », elle mène sa vie comme si elle n’était pas en train d’accomplir un exploit. En l’observant, je pense aux prouesses invisibilisées des conditions féminine, handie et bien d’autres, à ces tours de force constants auxquels elles obligent pour surmonter chaque jour mille obstacles et supporter mille charges, sans que cela ne soit aucunement reconnu ni valorisé. Je vois la suspensive danser là-haut, et me revient en tête le livre de Caroline Criado Perez, Femmes invisibles, dans lequel elle critique le design centré sur le modèle de l’homme valide moyen, de l’urbanisme aux médicaments en passant par la climatisation ou les outils, à l’exclusion de tous les autres corps et usages du monde. Elle y écrit par exemple : « Les femmes qui travaillent comme aides-soignantes, ou femmes de ménage, soulèvent parfois davantage de charges en une seule séance de travail qu’un ouvrier du bâtiment ou qu’un mineur. (…) Et quand ces femmes rentrent chez elles, c’est rarement pour se reposer : elles y entament une deuxième séance de travail, non rémunérée ... » [8] Un peu plus tard, la suspensive m’explique : « Le plus difficile, quand je suis suspendue, c’est d’arriver à la détente. Il y a beaucoup de tensions inutiles à nettoyer. Comme quand on lève les épaules pour couper les carottes, vous voyez ? »

Il y a toujours un autre pli
Je me laisse porter par le relief mouvant de Viva Cité, je traverse l’espace enfants, où jeux en bois, transats, tables de coloriage, tapis de jeux de construction et animations offrent un lieu accueillant pour les plus jeunes et leurs proches. Je me dis que les travaux de la géographe Édith Maruéjouls ont porté leurs fruits, elle qui travaille depuis plus de vingt ans à documenter les inégalités de genre dans les aménagements de l’espace public (rues, écoles, loisirs) et à imaginer des lieux inclusifs pour toutes et tous. Le féminisme, dans un festival, ne saurait demeurer une thématique parmi d’autres, pas plus que l’antiracisme ou l’antivalidisme : ce sont des manières de concevoir l’espace public, non pas comme reflet et réceptacle des dominations sociales, mais comme possibilité d’inventer et de mettre en œuvre un autre rapport aux autres et à soi-même, d’improviser collectivement de nouvelles manières de nous accorder. Un nouveau pli me ramène sur la place de l’hôtel de ville et au milieu d’un vaste cercle de public, la compagnie .Bart plonge dans Fièvre : six jeunes danseuses et danseurs se trouvent comme saisi·es par la musique, les rythmes saccadent leurs épaules, leurs bassins, leurs têtes, leurs pieds, en les prenant comme par surprise, en leur faisant traverser la ferveur, le plaisir, la puissance, l’agacement, le conflit, l’épuisement, l’entraide, la détermination, l’ouverture. Les catégories de genre semblent intégrées et débordées, chaque corps devient membre d’autres corps, c’est effrayant et magnifique à la fois, comme une mutation en vitesse accélérée ou au microscope. J’observe avec curiosité, en me disant que cette énergie collective pourrait ne jamais s’arrêter et nous emmener dans des endroits totalement imprévus.
Lors du spectacle de Sauf le dimanche, Assemblée, les gestes récoltés le matin se trouvent chorégraphiés, parlés, dessinés, mis en jeu, ils peuplent l’espace sous diverses formes. Parfois l’une ou l’autre membre de la compagnie sort de la scène pour devenir membre du public, avant de rebasculer au milieu du cercle. Une danseuse trace avec énergie une sorte de Z aplati et inversé au sol, elle interroge ses collègues et au-delà les spectateurs et spectatrices : à quel geste ce dessin vous fait-il penser ? Et les gestes imaginés viennent compléter les gestes récoltés. Puis elle en raconte la genèse réelle : c’était un ado racisé, l’un de ceux dont on dit qu’ils tiennent les murs, l’un de ceux qu’on trouve trop visibles, l’un de ceux qu’on diabolise. Quand elle est venue lui demander un geste, il a fait plusieurs fois ce grand mouvement horizontal des bras de part et d’autre du corps en disant : « On n’est rien, rien, rien, alors on reste là pour montrer qu’on existe au moins. » L’ado était présent au spectacle, dans le public, il était venu. Et j’y voyais un autre pli au croisement du féminisme et des arts de la rue, une manière inventive de refuser l’impossible, de remettre de l’ouverture là où tout semblait verrouillé. Comme le renversement, combatif ou ténu, d’un certain ordre établi, trois fois rien ou table rase. Comme l’exploration d’autres agencements de l’espace pour s’aviser qu’en effet, on peut y partager quelque chose de commun.
Par Juliette Volcler (jardinière, chercheuse indépendante et artiste sonore), Goupil (illustrateur), Coordination éditoriale : Sylvain Marchand