Pré-Covid, en 2019, on comptait en France 730 000 personnes travaillant dans le secteur culturel, pour 2,7 % de l’emploi total. [1] Passée cette crise, c’est tout un secteur, les arts vivants, [2] qui se relevait de l’épreuve en demande de sens. Culture empêchée, « bouchons » de programmation, reconversions professionnelles souvent motivées par un sentiment d’incompréhension totale de la part des gestionnaires de la crise... Les arts vivants, en particulier ceux de la rue, s’interrogent sur leur rôle. Naturellement exposés autrement à la circulation des personnes dans l’espace public, et moins dépendants des structures fermées pour se diffuser, les arts de la rue apportent un regard autre.
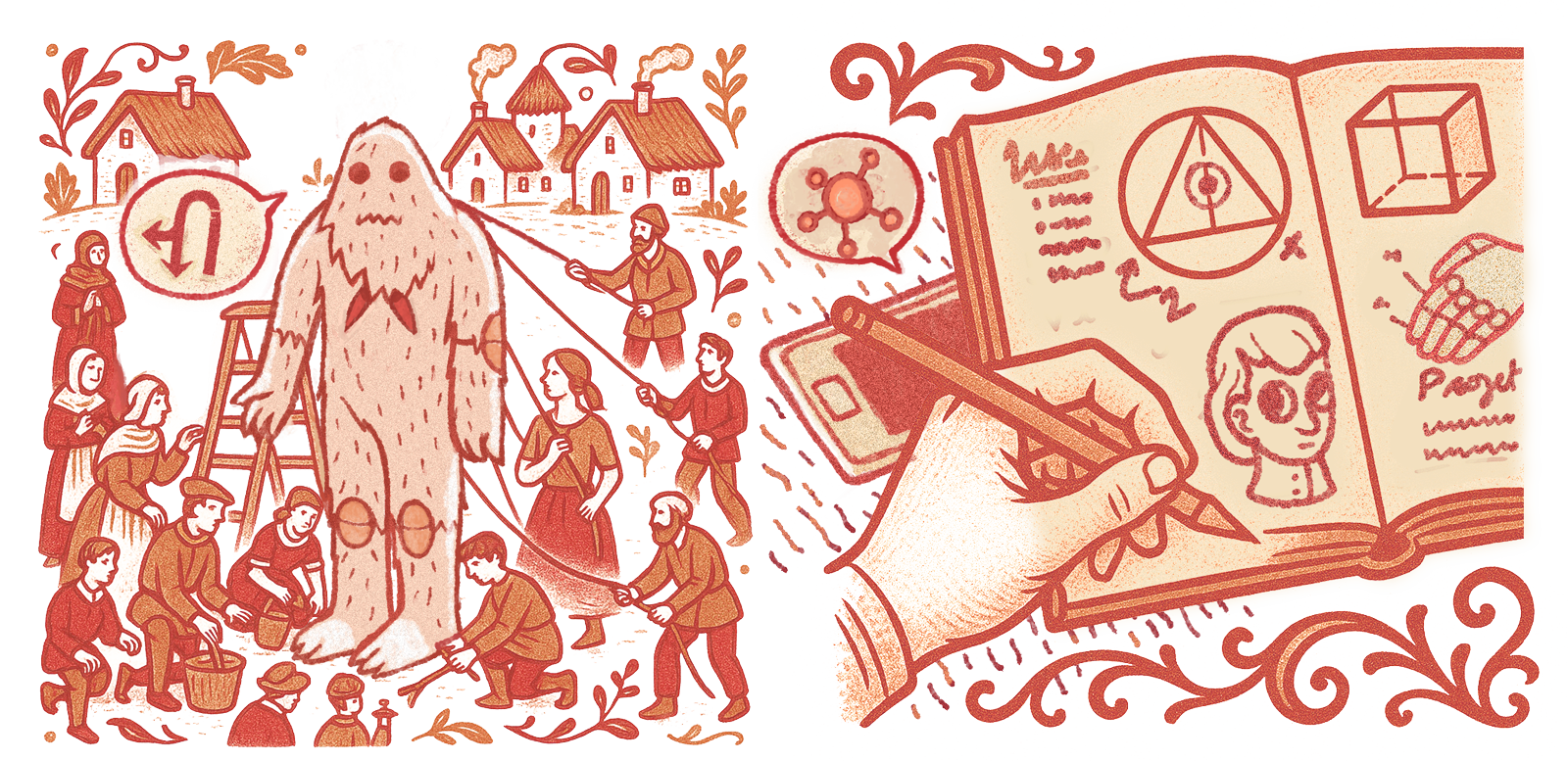
Les crises, qu’elles soient sanitaires, écologiques ou sociales, relèvent moins de situations conjoncturelles que d’un état structurel désormais permanent, les premières ayant entraîné ce dernier dans l’inévitable. Ce qui appelait autrefois réparation ou relance appelle désormais redirection : non plus revenir, mais réinventer.
L’écologie, du grec oikos - la maison - renvoie à la gestion de l’habitat, au sens large. Une science qui dépasse largement un imaginaire conservateur opposant la verdure à la civilisation, comme s’il s’agissait d’un agôn — une lutte — pour retrouver la vertu d’un Éden perdu. La civilisation mérite l’oikos : une pensée écologique qui englobe nos manières d’habiter, de créer, de vivre ensemble. Elle l’incarne, aujourd’hui.
Et si cette occurrence dramatique qui a immobilisé le monde entier avait été l’occasion non pas seulement de penser à nouveau la sobriété, mais d’initier une redirection écologique ? Et si le secteur du spectacle vivant n’attendait plus la catastrophe pour proposer des contre-modèles, viables, vivables et joyeux, plutôt que de s’adapter, chaque fois de justesse, aux prochains avatars d’une pensée économique globale dotée de l’empathie d’un char d’assaut ?
Si l’on a longtemps brandi le mot décroissance comme un signal d’alarme, le temps semble venu d’en déplacer les termes. Car il ne s’agit plus uniquement de critiquer l’excès, l’accélération, l’artificialisation du vivant. Il s’agit désormais de changer de trajectoire. C’est là toute l’ambition de la redirection écologique : orienter nos moyens, nos gestes, nos désirs vers des formes soutenables d’habiter le monde. Mais pour mieux en comprendre les enjeux, il reste essentiel de revenir sur certains fondements critiques de la pensée décroissante, dont plusieurs idées continuent d’éclairer les choix à venir.
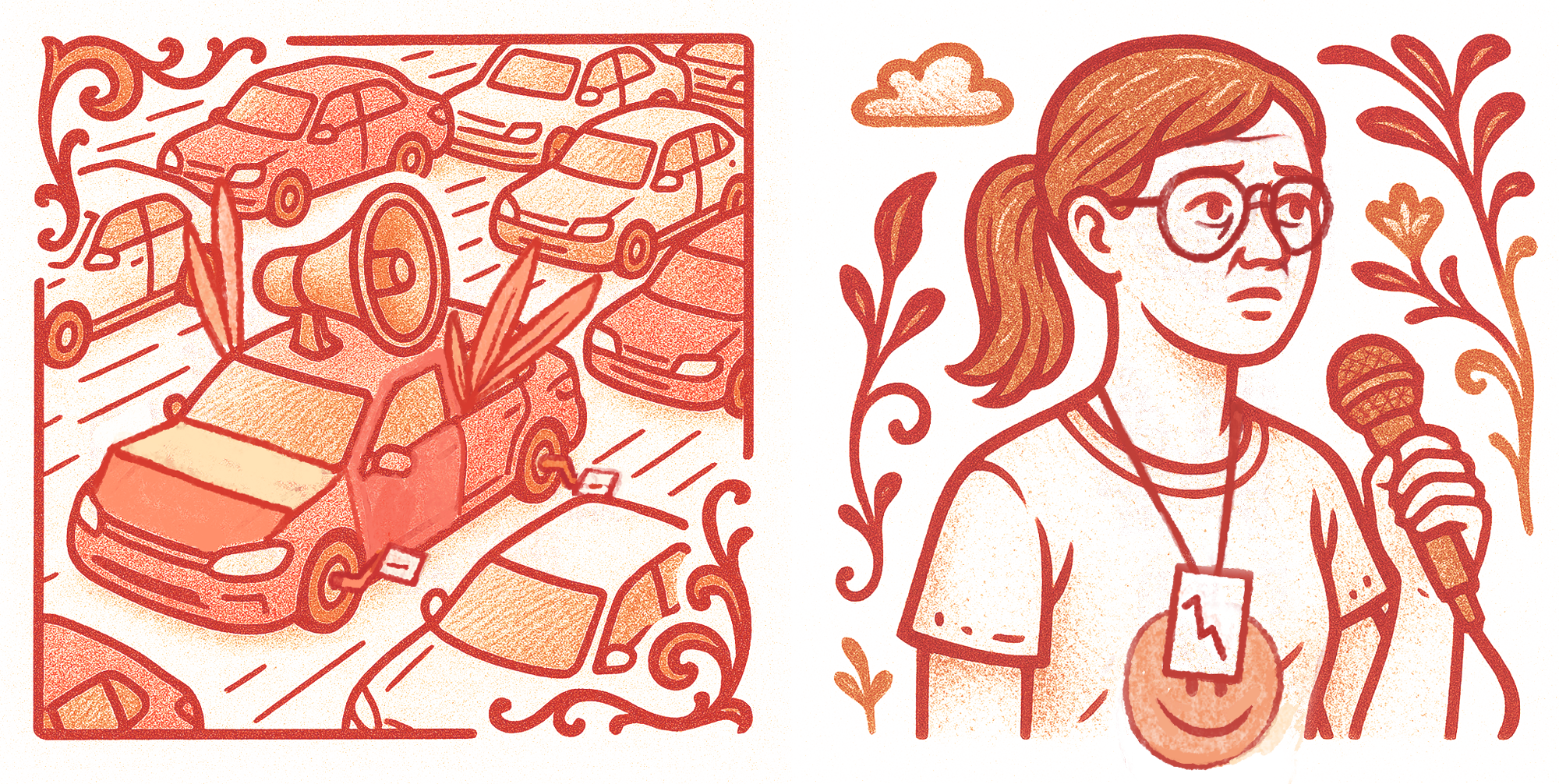
Hors des sentiers Malthus
Le principe de décroissance, entendu aujourd’hui comme réduction du productivisme en faveur d’une économie dite durable ou soutenable, n’a pas toujours signifié la recherche d’harmonie entre la ressource et son exploitant... du moins il faut s’entendre sur l’exploitant. On pense bien sûr à Thomas Malthus, économiste et prêtre anglican du 18ème siècle, dont la vision du rapport entre croissance démographique et abondance de ressources aboutissait forcément à une impasse : [3]population grandissante exponentiellement contre nourriture à production linéaire, il y a forcément un hic. Seuls régulateurs, les « obstacles malthusiens » que sont famines et épidémies … Au quotidien, dans le projet malthusien, sont prônés l’abstinence, le célibat, l’avortement et la contraception pour encadrer la population... essentiellement celle des travailleurs et paysans paupérisés. Une population jugée incapable de subvenir à ses propres besoins. La décroissance malthusienne ne souffre pas de solidarité ; elle ne s’occupe que de préservation de classe.
L’âge d’or de la notion de décroissance va commencer en 1968 avec l’apparition du Club de Rome et la publication 4 ans plus tard de son « Les limites à la croissance » (dit « rapport du Club de Rome ») : déjà en pleines 30 glorieuses, la question d’une économie responsable était soulevée. Scientifiques, industriels et économistes de 52 pays se retroussaient alors les manches pour recadrer l’économie, repenser la finance... Un rapport néanmoins critiqué pour son manque de précisions sur les mesures à adopter pour une « croissance zéro ». Une sonnette d’alarme.

Loin des grands clubs internationaux, des penseurs comme Serge Latouche ou André Gorz maintiennent et vitalisent la réflexion : le premier est partisan de « l’accroissance », système économique qui ne produit que le nécessaire ; le second (décédé en 2007) ajoute à l’humanisme écologiste l’utopie d’abolition du salariat - sortie totale du rapport de classes marxiste qui fera grincer des dents à gauche [4]mais amènera déjà à penser une autre gauche, éloignée des grands cercles dirigeants, incluant la décroissance dans un projet global.
Ces principes, nés dans le sillage de la critique de la croissance infinie, résonnent aujourd’hui avec une pertinence nouvelle, à l’heure où la redirection écologique interroge en profondeur nos pratiques, nos moyens et nos récits. Les arts de la rue, souvent en marge des cadres dominants, portaient-ils déjà - sans toujours le revendiquer - des réponses à ces nouvelles exigences ? Etaient-ils déjà préparés, sans le savoir - ou plutôt sans le désirer - à faire face à l’agrégat de crises qui redéfinit aujourd’hui l’expression publique ?

Créer au lieu de croître
Les solutions portées par ces courants critiques du productivisme convergent autour de l’utilisation de matériaux locaux, la limitation des transports et de la production excédentaire, ainsi que la mise en application de modèles décisionnaires alternatifs ; de quels moyens se dotent les compagnies des arts de la rue afin de s’emparer de ces contre-modèles ? Il s’agit ici de retrouver l’esprit premier d’une création située — c’est-à-dire ancrée dans un territoire, attentive à ses ressources et à ses liens — par l’économie de gestes, de matériaux et de forces.
Pour Benoît Mousserion de l’Homme Debout, compagnie spécialisée dans les formes déambulatoires avec marionnettes, le matériau est crucial. « On emploie de l’osier pour les marionnettes - pas les décors - car au nord de Poitiers se trouve la capitale de la vannerie, à Villaines-les-Rochers. Économiquement, c’est formidable : fabriquer un personnage principal de 8 mètres de haut nous revient à 1000 euros environ (2000 entièrement fini avec accessoires) ce qui n’est, honnêtement, rien du tout ! Ça rend le projet abordable quand la création est participative, comme lorsque nous intervenons dans les maisons de quartier par exemple. Et c’est une matière qui reste rigide 3 ans après la coupe ». [5] Choix durable, économie locale : l’Homme Debout a trouvé sa matière première dans une terre qui fait vivre des coopératives indépendantes. « On croit beaucoup au réemploi aussi ; fabriquer reste ce qui coûte le moins cher. Le reste, son, lumière, tissus... ce n’est pas la même échelle ».
Pour Maud Jegard, référente artistique de la compagnie Queen Mother, c’est le mouvement qui est une forme douce. Une façon de créer qui ne demande que l’énergie des personnes qui la portent. « Il y a dans l’éco-féminisme une intention de départ, mais je ne sais pas si le public le sait ». [6] Eco-féminisme ? Le constat de soumission de la nature à l’humain parallèle à celle des femmes aux hommes. Le capitalisme vécu comme une forme de patriarcat dominant l’environnement. Leur spectacle Futur.e.s propose une forme libre, déliée, laissant la place à des imaginaires nés du geste.
L’écoféminisme, comme déroulé premièrement par Françoise d’Eaubonne [7] en 1974 dans « Le féminisme ou la mort », raccorde l’agressivité d’un patriarcat dévoreur de milieux dits « naturels » à la façon dont la masculinité dominante relègue les femmes à la portion congrue de l’humanité, par une violence comparable ; en termes de colonisation des écosystèmes comme de brutalité domestique et sociale.
« Le geste parle plus que les mots. Je pense à des technologies plus douces – on aimerait avoir de la musique live au plateau avec nous, mais cela engendre d’autres coûts… De façon plus générale, avec Futur.e.s, on va chercher une fusion avec l’animal, le végétal. On regarde trop souvent la nature de façon extérieure ; ce qu’on dit, nous, c’est : nous sommes la nature. Et là on peut commencer à la défendre. » Et si la redirection écologique, au-delà de mesures chiffrables, commençait là : trouver de nouveaux récits où le vivant ne tient plus la place de l’accessoire, du jetable ? Si l’ultra-capitalisme est le récit brutal de l’asservissement du monde, quel nouveau conte raconter le soir au coin du feu ? Ainsi, les « formes douces » de création ne sont peut-être pas totalement visibles dans le résultat, mais sous-tendent tout un processus.
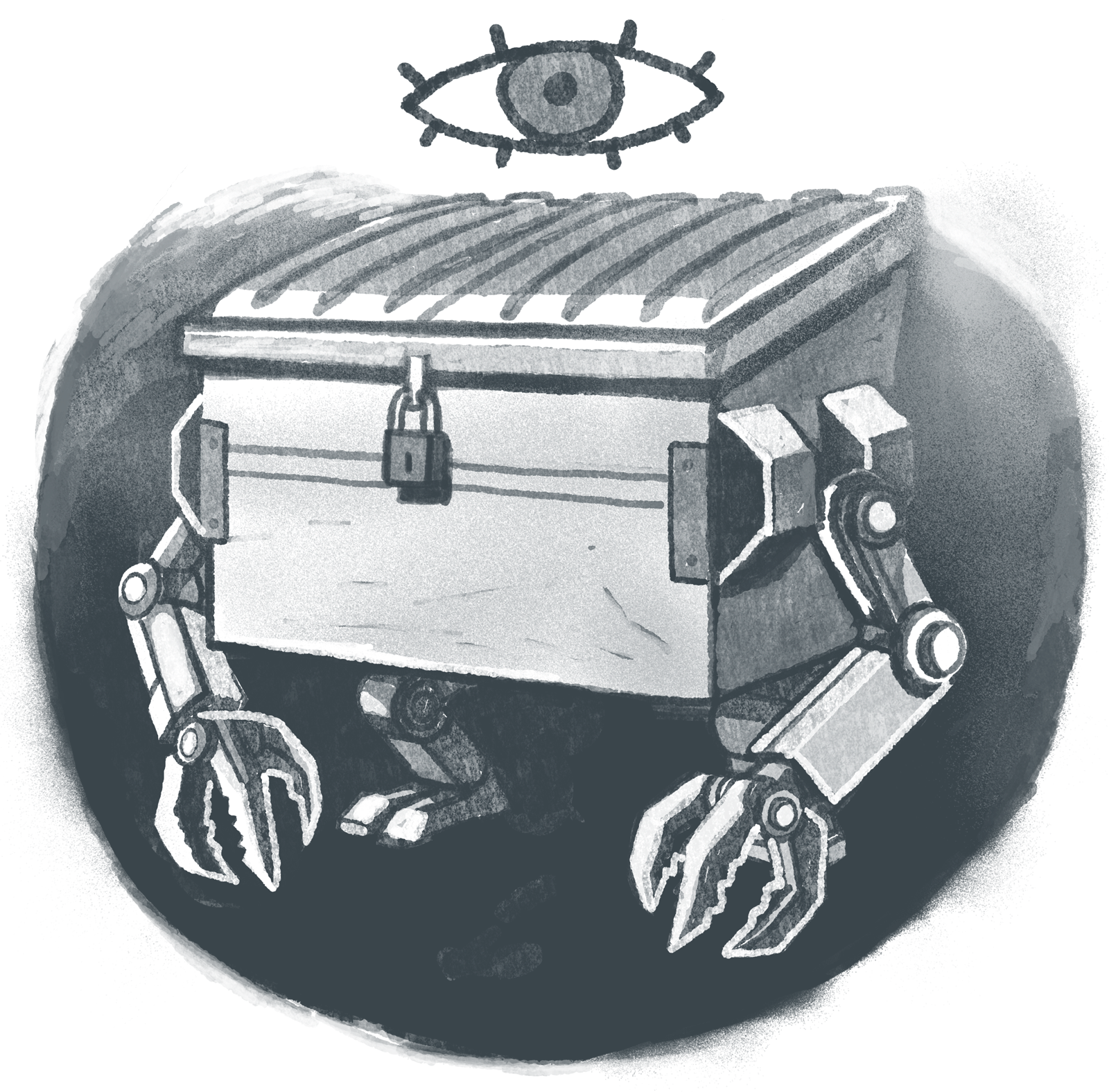
Récupérer du matériel, voilà aussi ce qui inscrit les arts de la rue au cœur des dynamiques actuelles. Pour Pierre Galotte de la compagnie Titanos, c’est même un des nerfs de la guerre. Ses formes foraines ne sont pas un décor : « c’est l’objet qui est au centre du projet, pas du tout l’arrière-plan ». [8] Et pour cette compagnie qui construit sans cesse, une solution : réutiliser. « Il y a un gros lieu à Nancy qui nous fournit, on les connaît bien... 1/3 du boulot de construction chez nous c’est la réactivité, avoir des plans de récupération au sens large. Avant, on pouvait se servir dans les bennes des grands magasins ; c’est scandaleux qu’elles soient fermées à clé partout maintenant. Comme si l’objet était encore possédé par les grands groupes même après la fin de son utilisation ! » Paradoxe : à l’heure de l’injonction nationale au tri sélectif, « libérer » un matériau des mandibules des poubelles est interdit.
« Dans les Vosges, il y a des tas de sapins inutilisables pour le bois d’œuvre à cause des scolies, des insectes ; donc on en achète parfois, quand on n’a pas le choix ». Également impliqué dans le festival Michto, Titanos en assure la scénographie depuis même avant la création de la compagnie, il y a 20 ans. « Là, on rassemble tout. C’est très immersif, comme un village à part entière. Il faut savoir que nos grandes structures sont en réalité constituées par l’assemblage de plusieurs petites formes ; c’est aussi une manière de faire des économies de moyens. »

A fond la forme
Au cœur de la conception d’une œuvre, il apparaît comme évident que la nécessité pousse à l’inventivité ; néanmoins, quel impact cette sobriété — parfois choisie, souvent contrainte — peut-elle avoir sur la création elle-même ? Les formes dites « douces », in situ, à matérialité légère, ne peuvent bien évidemment convenir à toutes les compagnies. Il existe autant de visions artistiques que de sensibilités créatives. « Évidemment ce n’est pas souhaitable et ce serait trop réducteur pour la diversité artistique des formes et des propositions. Mais c’est un modèle, qui en plus d’avoir un impact réduit sur l’environnement, sera plus résilient face à une époque où nos mobilités vont devoir être repensées. Et pas uniquement en proposant un déplacement plus léger pour les équipes artistiques, mais aussi celui des publics, en diffusant les œuvres sur l’ensemble d’un territoire », [9] appuie Léo Manipoud de Maison Courbe.
« Il ne faut pas attendre un effondrement pour transformer un modèle. On a créé un collectif pour résister à une pression capitaliste, celle du rendement, celle d’une création tous les ans. On voit des gens en burn-out, qui n’arrivent pas à en vivre... Nous, on voulait se passer la balle ». Maturer, prendre le temps, c’est l’une des préoccupations de la compagnie qui propose Obake, in situ de plein air mêlant danse, geste, cirque. « Il faut se laisser le temps de vivre pour proposer des choses qui ont du sens ». Un éloge de la lenteur qui rejoint pleinement les principes de la décroissance. Et puis il y a l’extérieur, évidemment. « C’est un lien différent avec l’environnement ; c’est plus direct, sensoriel. On habite le lieu, on est en lien avec l’invisible, c’est un pistage d’êtres surnaturels et primaires (l’obake est une créature métamorphe du folklore japonais), et aussi un rituel qu’on destine au lieu — souvent un grand arbre, en lien avec les souffrances du végétal ».
Pour prolonger cette démarche, Maison Courbe mise sur l’organisation collective. « Nous, on n’a pas peur de partager la direction artistique. Avec Maison Courbe, on est 5 directeur.ices pour s’alléger. Cette souplesse organisationnelle peut être soutenue par le collectif ; les gens ne créent pas sous pression. L’industrie de la musique, par exemple, c’est le star-system : c’est le nom qui compte. Ici, on se met au service d’une envie commune. Il y a des œuvres qui nous touchent, un bouquin, une pièce... et on n’a pas forcément besoin de connaître le nom de l’artiste ».
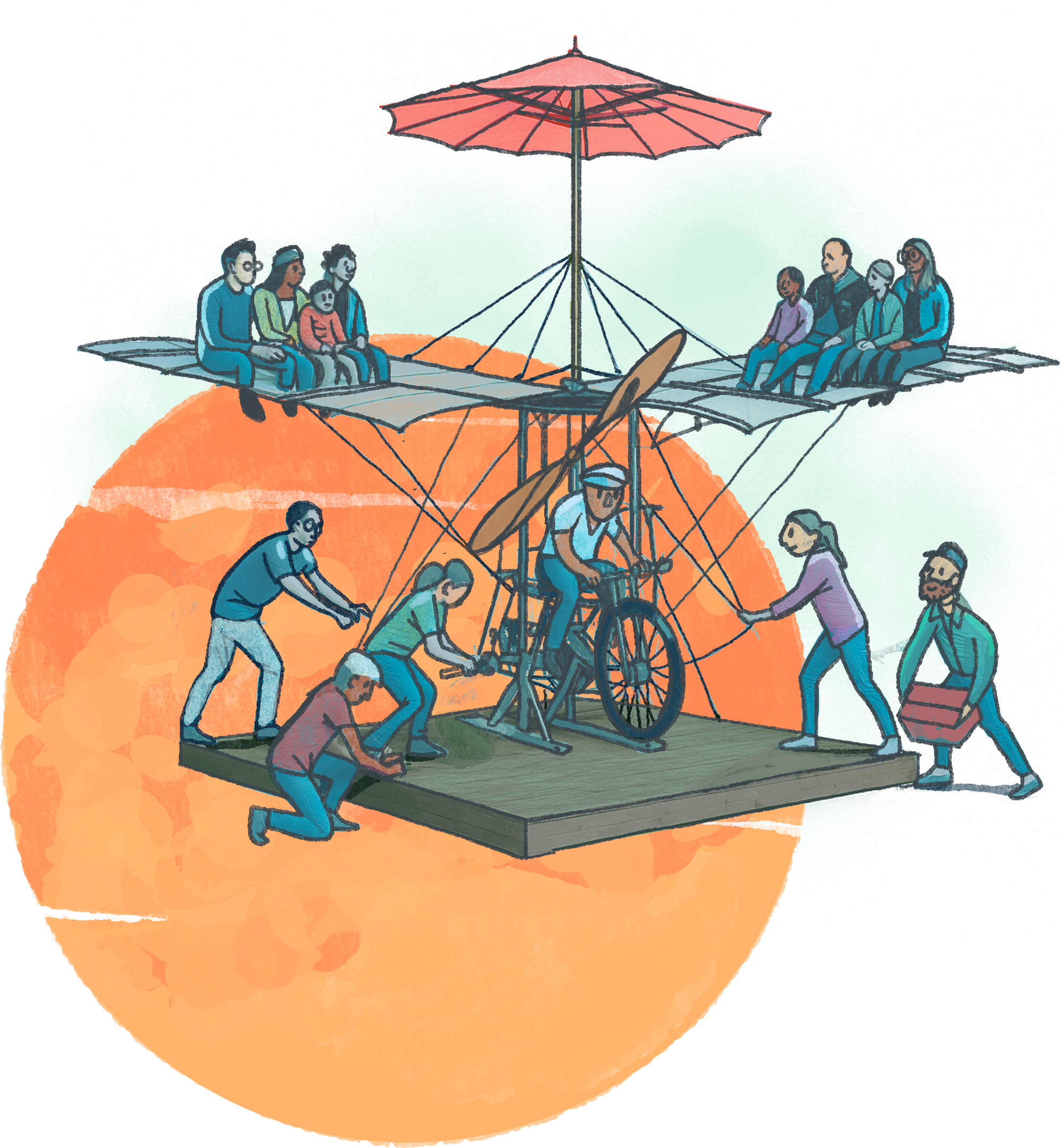
La faim justifie les moyens
Par sa nature mobile, souvent adaptable, et sa situation au premier plan de la réconciliation entre publics et artistes dans des lieux de circulation, le monde des arts de la rue réfléchissait déjà à de nouveaux modèles bien avant la dernière crise sanitaire mondiale. Forcément impacté, secoué, ce monde à part dans le spectacle vivant (englobant plusieurs esthétiques) a pourtant su rebondir. La création actuelle intègre davantage l’allègement des formes, l’économie circulaire et une écriture de plus en plus imprégnée des problématiques environnementales. Bien sûr, souvent tributaire des choix budgétaires des collectivités territoriales, le secteur reste vulnérable aux évolutions des soutiens publics. L’existence de ces compagnies tient souvent à ce qu’on pourrait, de loin, juger comme une futile économie de bouts de chandelle. Il n’en est rien. C’est à force de se rapprocher des acteurs locaux et de proposer des imaginaires faisant taire la faim productiviste que la création, telle qu’on l’envisage encore aujourd’hui, peut subsister.
Par Antoine Boyer (journaliste - auteur), Goupil (illustrateur), Coordination éditoriale : Sylvain Marchand